 1948 : Les anarchistes rejoignent à regret la CGT-FO (version longue)
1948 : Les anarchistes rejoignent à regret la CGT-FO (version longue)
Il n’était pas écrit d’avance que la CGT-Force ouvrière devait être une centrale syndicale réformiste et pro-américaine ! C’est du moins ce que certains anarchistes et syndicalistes révolutionnaires ont voulu croire lors de sa fondation, en avril 1948.
Une version courte de cet article est disponible ici
Les 12 et 13 avril 1948, salle de la Mutualité à Paris, se tient le congrès constitutif d’une nouvelle confédération syndicale : la CGT-Force ouvrière (CGT-FO), que tout un chacun appellera communément FO. C’est le résultat de la troisième et dernière grande scission de la CGT.
La première avait eu lieu en 1921 quand la fraction réformiste, avec Léon Jouhaux, avait accaparé la direction de la CGT et provoqué la scission des communistes et anarchistes qui avaient alors créé la CGT unitaire (CGTU). Cinq ans plus tard, une partie des anarchistes, déçus d’une impossible cohabitation avec les « moscoutaires », avaient sans grand succès impulsé une troisième confédération, la CGT syndicaliste révolutionnaire (CGT-SR). CGT et CGTU s’étaient réunifiées une première fois en avril 1936, à l’époque du Front populaire.
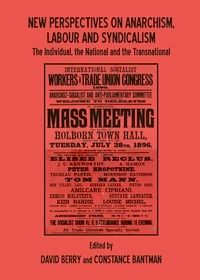
La deuxième rupture, qui avait eu lieu en 1939, n’était pas à proprement parler une scission, mais une exclusion : celle des staliniens ayant refusé de désapprouver le pacte germano-soviétique. Quatre ans plus tard, sous l’Occupation, des pourparlers de réunification avaient eu lieu clandestinement au Perreux-sur-Marne, en banlieue parisienne. En vertu des accords du Perreux, les réformistes avaient obtenu la majorité au bureau confédéral : 5 secrétaires (Bothereau, Neumayer, Saillant, Buisson, Gazier) contre 3 aux staliniens (Racamond, Raynaud, Frachon), ainsi que le secrétariat général pour ce vieux bureaucrate madré de Léon Jouhaux. Ces proportions étaient censées refléter les rapports de forces de 1936.
Dans la réalité, la guerre et la Résistance avaient rebattu les cartes et le « parti des 75 000 fusillés », minoritaire au BC, s’est trouvé hégémonique dans la centrale qui, en 1945, est au faîte de sa puissance : 5 millions d’adhérentes et d’adhérents revendiqués.
Staliniens et réformistes alliés pour museler classe ouvrière
Ces années 1945-1947 sont une curieuse parenthèse dans l’histoire du mouvement ouvrier français. C’est l’« unité nationale », qui fait suite à la Résistance. Socialistes et communistes, qui sont au gouvernement avec les démocrates-chrétiens, ont décrété que la lutte des classes était suspendue. Le PCF est alors capable de changer de slogan comme de chemise. En 1945-1947, le mot d’ordre c’est : « Travailler d’abord, revendiquer ensuite » et même « La grève, c’est l’arme des trusts ! ». Pourtant, le prolétariat a faim. La vie est dure dans cette France à reconstruire. Aussi la CGT emploie-t-elle toute son énergie à empêcher les grèves et les luttes qui éclatent ici et là [1].
Au sein de la centrale, les réformistes, déçus d’avoir perdu la majorité, se regroupent au sein des Amis de Force ouvrière, le bulletin dirigé par Robert Bothereau. Pour le reste, l’alliance stalino-réformiste pour museler la classe ouvrière va fonctionner parfaitement jusque fin 1947. Seules certaines minorités syndicales dénoncent ce véritable assassinat du syndicalisme.
La première fissure dans la grande centrale apparaît en mai 1946, quand les anarcho-syndicalistes font scission. En décembre, ils fondent la Confédération nationale du travail (CNT, en hommage à leurs homologues espagnols) qui va rassembler quelques milliers d’adhérentes et d’adhérents.
Entre-temps, le 30 juillet 1946, une grève a éclaté aux PTT, et s’est poursuivie contre la volonté des staliniens. Les syndicalistes qui l’ont soutenue scissionnent alors de la CGT et fondent la Fédération syndicaliste des PTT. La série de grèves qui se déclenche ainsi entre le printemps 1946 et l’automne 1947 aboutit à la création de nouveaux syndicats autonomes, notamment à la SNCF, dans le métro et la métallurgie (chez Jeumont, Unie, Télémécanique, Arsenal aéronautique et ailleurs) [2]. Ces autonomes s’attribuent le nom de comités d’actions syndicalistes (CAS) et créent une coordination. C’est dans une dynamique analogue que se crée, aux usines automobiles de Billancourt, le Syndicat démocratique Renault (SDR), après la grève d’avril-mai 1947. Mais Le SDR, contrôlé par un groupe trotskiste, reste isolé des CAS.
Avec la CNT, ces CAS sont les premiers à vouloir recréer un syndicalisme indépendant et combatif. Ils sont viscéralement antistaliniens et les réformistes leur inspirent plutôt de la méfiance car, pour l’instant, les bonzes de FO préfèrent rester les otages choyés des staliniens au bureau confédéral CGT.
La Guerre froide provoque la scission
Pourtant, la coopération entre réformistes et staliniens va s’interrompre brutalement. La formation de syndicats autonomes en-dehors de la CGT avait déjà fragilisé la position des Amis de FO dans la centrale. Mais ce qui va les convaincre de franchir le pas de la scission, c’est… le Plan Marshall.
En octobre, au sommet de Szlarska-Poreba en Pologne, les PC italien et français ont reçu l’ordre d’appliquer désormais la doctrine Jdanov de Guerre froide. Une semaine plus tard, le comité confédéral national de la CGT repousse par 832 mandats contre 101 une motion de Robert Bothereau déclarant « utile l’aide américaine à la France ». Le mois suivant, les staliniens déclenchent des grèves en rafale contre… le Plan Marshall. Des grèves « politiques », moins en rapport avec les aspirations ouvrières qu’avec les desideratas de Moscou : des « grèves Molotov », en référence au ministre soviétique des Affaires étrangères [3] qui avait menacé la France et la Grande-Bretagne de « grabuge » si elles acceptaient le plan états-unien.
Le 18 décembre 1947, la conférence nationale des Amis de FO décide la scission. Leurs dirigeants qui, à l’exception de Bothereau, n’en voulaient pas, se voient contraints, dès le lendemain, de démissionner du bureau confédéral [4].Ceux qui coopéraient sans problème avec les staliniens quand il s’agissait de casser les grèves, ne le peuvent plus quand il faut préférer les intérêts de Washington à ceux de Moscou. Quoiqu’il en soit, la scission FO, ouvertement réformiste et pro-américaine, fait l’effet d’un coup de tonnerre dans le paysage syndical français.
Dans le contexte de la Guerre froide qui oblige chaque courant politique à « choisir son camp » entre les États-Unis et l’URSS, la FA, qui en 1945 a unifié le mouvement libertaire français, défend la stratégie dite du « troisième front » : ni Staline, ni Truman. Toute la question est donc, pour elle, de réussir à faire vivre un mouvement social indépendant des deux impérialismes rivaux. La CNT, où la FA jouit d’une influence prépondérante, est la clef de cette stratégie, bien que des militantes et militants de la FA soient également syndiqués à la CGT ou chez les autonomes. Chaque semaine, une page entière de l’hebdomadaire Le Libertaire est réservée à la commission syndicale de la FA, animée par Maurice Joyeux (Métaux-CNT, qui signe parfois Montluc) et Jean Boucher (Livre-CGT, qui signe parfois Normandy). On y fait une continuelle promotion de la CNT.
La CNT se tourne sans succès vers les autonomes
Quand les Amis de FO scissionnent et qu’une nouvelle confédération s’annonce, la FA comprend illico quelle concurrence va menacer la CNT, qui jusqu’ici faisait figure de seule alternative à la CGT. Dès la semaine suivante, le comité national de la FA appelle, dans Le Libertaire, à « s’écarter EGALEMENT de la centrale stalinienne de Frachon et de la centrale réformiste de Jouhaux, et ceci pour appuyer l’action de […] la CNT » à laquelle il faut « rallier les syndicalistes des organisations autonomes à caractère révolutionnaire » [5].
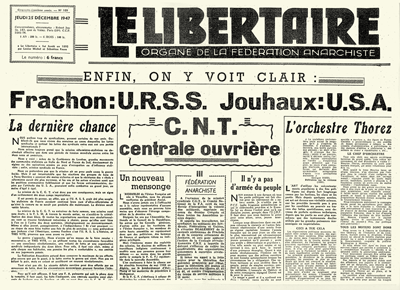
La CNT se tourne donc, mais un peu tard, vers les syndicats autonomes. La petite organisation de la rue de la Tour-d’Auvergne se dépêche de proposer des négociations d’adhésion aux CAS… mais ceux-ci sont déjà en pleine tractation avec FO. Bientôt la Fédération syndicaliste des PTT de Camille Mourguès et le CAS des cheminots, de Laurent, décident de s’associer aux Amis de FO pour fonder une nouvelle confédération. Le CAS de la métallurgie, lui, hésite. Le 2 Janvier 1948, ses dirigeants (Hervé, Juliot et Racine) rencontrent les délégués de la CNT (Jacquelin, Juhel, Snappe et Fontenis). Au terme de la discussion, ils refusent de rallier le drapeau rouge et noir, et proposent plutôt à la CNT de constituer ensemble un pôle révolutionnaire dans la confédération que les Amis de FO veulent lancer. Il n’y aura pas d’accord [6].
Le 31 mars 1948, Maurice Joyeux assiste à un congrès de métallurgistes antistaliniens à Puteaux. On y compte un tiers d’Amis de FO et deux tiers d’autonomes. Ces derniers proposent la création d’une Centrale syndicale démocratique, indépendante des partis, des gouvernements et des États, selon les principes de la Charte d’Amiens, et ayant pour but la gestion ouvrière effective. Ils demandent que la nouvelle centrale ne porte pas le nom de CGT-FO, qu’elle ne soit pas affiliée à la Fédération syndicale mondiale (FSM), théâtre des luttes d’influences entre l’impérialisme soviétique et l’impérialisme américain. Ils exigent la limitation du mandat des permanents syndicaux à trois ans [7]. Les Amis de FO refusent. Déçu par la CNT, déçu par les Amis de FO, le CAS des Métaux gardera donc son autonomie.
Pendant les quelques semaines qui séparent la scission de FO du congrès fondateur de la nouvelle confédération syndicale, le Lib ne cesse de mettre en garde les jeunes travailleuses et travailleurs enthousiasmés par FO, et concentre ses attaques sur Léon Jouhaux. « Brasseur de merde et mangeur de boue, comme dit l’autre, Jouhaux ça commence par la même lettre que Judas » signe rageusement Paul Lapeyre [8].
Mais les invectives et l’apologie de plus en plus appuyée de la CNT par Maurice Joyeux n’y font rien.
Plusieurs syndicalistes de la FA, jusque-là syndiqués CGT, décident de s’engager de façon critique dans le processus de création de la nouvelle centrale. Ainsi de Charles Ridel à Grenoble qui, dans le Lib, estime que « si la maison est habitable, elle abritera toutes les tendances. […] Ni papes syndicaux, ni bureaucrates enkystés. Retour au syndicalisme souple, vivant, lié aux masses, fédéraliste. C’est la seule garantie qu’exigent les révolutionnaires » [9]. Dans le Maine-et-Loire, où l’UD-FO est animée par des militants, comme Raymond Patoux, qui se disent proches du syndicalisme révolutionnaire, l’animateur de la FA, Gabriel Tharreau, également secrétaire de la CNT, estime qu’il faut associer la CNT à FO dans la perspective de fonder une nouvelle centrale. Dès Le Libertaire du 1er janvier 1948, il explique que dans le Maine-et-Loire, les discussions ont commencé.
Des minorités « révolutionnaires » à la CGT-FO
Quand, les 12 et 13 avril 1948, salle de la Mutualité à Paris, s’ouvre le congrès fondateur de la nouvelle confédération syndicale, les débats sont vifs sur ce que doit être son identité. L’antistalinisme est le seul dénominateur commun des quelques dizaines de délégués présents dans la salle. Pour le reste, les jeux sont ouverts. La majorité, formée par les Amis de FO, est indéniablement pro-américaine et réformiste. Mais elle doit compter avec trois minorités qui vont faire front commun pour proposer une autre orientation : ce sont le courant de l’Union des cercles d’études syndicalistes (UCES), les ex-autonomes et les anarchistes.
L’UCES a été impulsé par des cadres issus de la fédération des Ingénieurs et Techniciens, dissoute par la CGT en mars 1945. Ce courant aujourd’hui méconnu se réclame étrangement du syndicalisme révolutionnaire. En réalité, il est surtout hostile à un réformisme sans idéal. Fasciné par le modèle fordiste à l’américaine, il prône la cogestion, et préfigure ce que sera le « syndicalisme d’expertise » de la CFDT trente ans plus tard, toujours prompt à donner des conseils de gestion à l’État et au patronat. L’UCES a pour figures de proue André Lafond, de la fédération du Rail, et Raymond Le Bourre, du Spectacle. Son bulletin, L’Action sociale, influence certains dirigeants autonomes et secrétaires d’UD comme Patoux (Maine-et-Loire) et Hervé (Indre-et-Loire).
Les syndicats autonomes représentent eux une galaxie en réalité plus vaste et plus ouvrière que les Amis de FO, mais leur projet syndical est assez flou. Au congrès fondateur de la nouvelle CGT, leurs porte-parole sont Camille Mourguès, des PTT et Laurent, des cheminots.
Les syndicalistes de la Fédération anarchiste ou proches sont également présents dans la salle. Ce sont par exemple Alexandre Hébert, Suzy Chevet ou Albert Périer. On verra plus loin quelles sont les idées qu’ils vont porter au congrès.
En fait une quatrième minorité existe, mais elle est absente du congrès fondateur. Il s’agit des syndicalistes révolutionnaires de La Révolution prolétarienne. Cette revue historique est animée par le vieux Pierre Monatte, figure de la CGT d’avant 1914. Bien que de plus en plus philo-américaine, elle plaide pour que la nouvelle confédération soit indépendante de tout parti et de toute idéologie. Des militants comme Roger Hagnauer ou Charles Ridel seront représentatifs de ce courant.
Dans les débats du congrès, les exigences des minoritaires sont de trois ordres [10].
Primo, que la nouvelle organisation ne se nomme pas CGT-FO. Force ouvrière n’est en effet que le nom d’une tendance particulière. Or le but est de construire une centrale syndicale indépendante et plurielle. Le nom proposé en alternative à CGT-FO est « Confédération syndicaliste des travailleurs de France » (CSTF) [11]. Les anarchistes appuient cette proposition.
Secundo, que la nouvelle organisation ne s’affilie pas à la FSM. L’anarchiste Albert Périer, du syndicat des techniciens d’Angers, suggère même une adhésion à l’Association internationale des travailleurs (AIT, anarcho-syndicaliste), qui a fait « ses preuves dans les époques héroïques du syndicalisme ».
Tertio, que la commission administrative confédérale soit élue par le congrès, « émanation directe de la base », explique Alexandre Hébert, des cheminots de Nantes, et pas par le comité confédéral national, qui est composé des secrétaire d’unions départementales et de fédérations professionnelles – et, le plus souvent, de caciques réformistes. L’anarchiste Suzy Chevet, du syndicat des agents du ministère du Travail, défend la même option.
À ces trois exigences qui font consensus parmi les minoritaires, les anarchistes en ajoutent une quatrième, qu’ils portent seuls : que la nouvelle organisation retire de son préambule la reconnaissance de « l’État démocratique comme la seule forme d’État dans laquelle le syndicalisme puisse vivre libre ». Alexandre Hébert argumente qu’en ces temps de nationalisations, l’État tend à remplacer le patronat, et que le syndicalisme doit le considérer comme un ennemi, au même titre que le patronat.
Les minoritaires argumentent, mais rien n’y fait. Le résultat des votes est sans appel : 80 % approuvent le titre de CGT-FO pour la nouvelle centrale ; 82 % approuvent son préambule ; 77 % approuvent ses statuts et 69 % sont favorables à son adhésion à la FSM [12].
Dépasser le cadre de la CNT
Le congrès fondateur de la CGT-FO s’achève donc sur un triomphe sans à-coup de la direction réformiste. À la Fédération anarchiste, les commentaires vont bon train. Dans Le Libertaire, la sentence tombe, définitive, sous la plume de Maurice Joyeux : « La minorité syndicaliste révolutionnaire sort écrasée de la confrontation. Ceux qui avaient encore – et de bonne foi – espéré refaire une CGT rénovée peuvent mesurer toute l’étendue de leur erreur. [13] » Malgré tout, pour la première fois, le ton de Maurice Joyeux a changé. Contrairement à son habitude, il ne termine pas son article par un appel vibrant à rejoindre la CNT, « seule centrale ouvrière ». En fait, le sigle CNT n’apparaît même pas dans son article : « Il est encore possible, écrit-il en conclusion, quoique plus difficile qu’il y a cinq mois, de réaliser la centrale nécessaire, la centrale indispensable, la centrale révolutionnaire qui permettrait seule de faire échec aux staliniens, et c’est pour cela que notre commission syndicale [de la FA] pense qu’il est indispensable de rassembler le plus rapidement possible les syndicalistes dans une vaste conférence qui tracera les grandes lignes d’un syndicalisme indépendant des partis, des castes, de l’État : d’un syndicalisme majeur. »

La suite de son parcours l’a fait haïr par son ancienne famille politique. En août 1914, il entraîne la CGT dans l’union sacrée anti-allemande. En 1921, menacé par la montée des révolutionnaires, il provoque la scission de la CGT. En décembre 1947, il devient président de la CGT-FO jusqu’à sa mort.
Maurice Joyeux et Jean Boucher esquissent là une orientation nouvelle. La CNT est dans une passe délicate depuis que les postiers et les cheminots autonomes ont préféré rallier FO plutôt que le drapeau rouge et noir. Mais dans l’esprit de Joyeux et d’un certain nombre de camarades, il est encore temps de rattraper le coup avec le CAS des métaux, resté autonome, en optant pour une stratégie plus souple : il ne s’agit plus de lui proposer l’adhésion pure et simple à la CNT, mais d’œuvrer ensemble à une recomposition qui aboutirait à une nouvelle confédération, distincte de la CGT comme de la CGT-FO. C’est la continuation, avec une tactique différente, de la ligne « Ni Staline ni Truman », ni « CGT-Kominform » ni « CGT-Wall Street ».
Les militants les plus influents de la FA – Joyeux et Fontenis – vont désormais travailler à faire passer cette ligne dans la CNT [14].
Gagné à cette stratégie, le bureau confédéral de la CNT prend contact dès le mois de juin avec le CAS des métaux et la minorité révolutionnaire de la CGT-FO. On programme pour l’automne une « conférence nationale d’unité syndicaliste ». En août, la CNT appelle à constituer des « cartels d’action » dans chaque entreprise. Le IIe congrès confédéral, qui se réunit à Toulouse du 24 au 26 septembre, valide cette stratégie et appelle clairement à la constitution d’une nouvelle « centrale », fondée sur la lutte des classes, l’action directe, l’anticapitalisme et « la substitution des organismes syndicaux aux organismes d’État » – une phraséologie typiquement syndicaliste révolutionnaire. En conclusion, le congrès « s’adresse spécialement à tous les syndicats autonomes et minorités syndicales d’accord avec ces principes et finalités, pour se réunir à la CNT pour la constitution de cette centrale » [15]. Cette ligne est ensuite défendue avec succès par Joyeux au IVe congrès de la FA, à Lyon, trois semaines plus tard. La FA abandonne alors le soutien exclusif à la CNT, et prend désormais position pour la convergence de tous les syndicats « restés en-dehors de la servitude des partis » [16].
Cette nouvelle orientation est au diapason d’une initiative séparée des minorités FO dites « de l’Ouest ». Un mois après le congrès fondateur de la CGT-FO qui a vu leur déconfiture, elles avaient en effet publié un manifeste qui appelait à un « regroupement » de « tous les syndicalistes quelle que soit leur appartenance » pour « défendre les intérêts des travailleurs en-dehors de toutes influences politiques, confessionnelles ou étatiques » [17].
Les conditions d’une réussite semblent donc réunies, n’était cette note discordante venue de La Révolution prolétarienne, où le vieux Pierre Monatte regretté publiquement que la FA s’isole en n’allant pas à FO. Maurice Joyeux lui répond, agacé que la Conférence nationale des minorités syndicalistes « et elle seule, peut décider un retrait CONCERTÉ, SPECTACULAIRE, simultané de toutes les minorités, de toutes les centrales existantes, retrait qui, par son caractère de masse, pourrait provoquer le “choc psychologique” nécessaire à un départ en “flèche” d’une nouvelle éventuelle centrale syndicale [18] ».
La création du Cartel d’unité d’action syndicaliste
Les 19 et 20 novembre 1948, c’est enfin l’heure de vérité.
La conférence nationale des syndicats autonomes se réunit rue Scribe, à Paris 9e. On y retrouve les CAS, la minorité de la CGT-FO (dont Le Bourre) et l’École émancipée (tendance révolutionnaire de la FEN). Mais la minorité de la CGT est également présente, avec Boucher, du Livre, et les trotskistes de la tendance Unité syndicale avec Pierre Lambert. La CNT, enfin, est représentée par Édouard Rotot et Maurice Joyeux. En revanche, à la surprise générale, les « UD de l’Ouest » de FO sont absentes. Elles avaient pourtant promis leur participation dès le mois de juin.
Après deux jours de discussions, la conférence s’achève sur un semi-échec pour les anarchistes, semi-échec doublé d’une certaine désillusion sur leurs alliés. La phraséologie anticapitaliste des autonomes dissimule en fait assez mal leur confusionnisme et l’inclination de certains de leurs chefs pour le gaullisme. Ainsi de Clément, du Métro, ou de Racine, des métaux, qui fait l’éloge de l’association capital-travail ! [19]. Par ailleurs, ces militants ont annoncé la naissance de leur propre structure : la Fédération nationale des syndicats autonomes (FNSA) [20]. Restait à savoir que proposer aux diverses structures réunies là. Deux projets se sont fait concurrence. La CNT a invité à la « constitution immédiate de la nouvelle centrale syndicale » indépendante des deux blocs impérialistes… et a ajouté de façon assez maladroite que cette nouvelle centrale s’affilierait à l’AIT anarcho-syndicaliste [21]. Plus malins, les trotskistes ont proposé un « cartel de liaison entre les diverses minorités éparses ». C’est cette seconde solution, moins contraignante, qui a été adoptée, sous le nom de Cartel d’unité d’action syndicaliste (CUAS). Même si la charte du CUAS reprend toutes les thématiques du syndicalisme révolutionnaire, c’est une maigre consolation vu l’opportunisme patent des autonomes et la duplicité supposée des trotskistes. Pour Rotot et Joyeux, il est évident que ces derniers ne veulent pas d’une nouvelle centrale au sein de laquelle les anarcho-syndicalistes joueraient un rôle de direction [22]. Et puis, l’absentéisme des UD de l’Ouest pose question. Quelle était la portée véritable du manifeste d’Angers ? Exprimait-il une orientation sincère, ou n’était-il qu’une « bombe à usage interne » pour peser dans les luttes de fraction au sein de la CGT-FO, comme le suggèrera Joyeux deux mois plus tard [23] ? Albert Périer répondra, piqué au vif, en accusant « Paris, nombril du monde » sans donner de réponse convaincante [24]. Boucher insinuera quelques mois plus tard que peut-être la « fauteuillite » avait dissuadé les dirigeants FO de l’Ouest de rejoindre leurs camarades du CUAS car « rien, nous disons bien rien, ne sépare syndicalement ceux-ci de ceux-là » [25].
Mais à défaut de grives on mange des merles… et la création du CUAS est saluée dans Le Libertaire comme un progrès significatif. Dans de nombreuses entreprises, des cartels se mettent en place sous des noms divers. En Gironde ou dans le Maine-et-Loire, des regroupement s’étaient formés dès avant le congrès fondateur de la CGT-FO. Ainsi, en Gironde, le bureau du cartel comprenait 3 CNT, 2 autonomes et 1 FO [26] ; dans le Maine-et-Loire le « comité de coordination » formé en mars comprenait 5 FO et 4 CNT [27]. Dès juin il s’était transformé en une « UD syndicaliste confédérée » dans l’orbite de FO, regroupant les sections de FO, de la CNT et des autonomes. Gabriel Tharreau est, avec Patoux, membre de sa commission administrative.
Si le regroupement syndicaliste semble donc bien amorcé à la base, l’avenir du CUAS semble compromis par des tendances centrifuges. Trois mois après son lancement, Pierre Monatte, dans La Révolution prolétarienne, ne cache plus son scepticisme : « au fond, écrit-il, les différents courants syndicalistes révolutionnaires ne désirent pas tellement s’unir et se fondre. Chacun – autonomes, CNT, partisans de FO – reste convaincu d’avoir pleinement raison et de constituer le pôle de rassemblement » [28].
Fuite en avant de la CNT
Même si la conférence de novembre n’a pas donné les résultats escomptés, les militants de la FA ne perdent pas l’espoir que le CUAS soit le prélude à une nouvelle centrale dans laquelle les anarcho-syndicalistes auraient le leadership. Mais voilà que c’est la CNT qui ne suit plus. Ses effectifs sont en train de régresser [29]. Du coup la petite organisation se replie sur elle-même. N’aurait-elle pas, finalement, plus à perdre qu’à gagner dans une « nouvelle centrale » ?
Comme pour confirmer ces craintes, le 1er mai 1949, l’UD-CNT du Maine-et-Loire fusionne dans l’UD-FO. La réaction ne se fait pas attendre. Le 29 mai, le comité confédéral national de la CNT décide de se séparer du CUAS, au grand scandale de certaines unions régionales (Bordeaux, Toulouse) et de la fédération du Rail. La confédération juge désormais que la stratégie cartelliste « a compromis sérieusement la vitalité et l’unité de notre organisation [30] ».
Cette volte-face de la CNT annihile la stratégie de rassemblement des minorités syndicalistes révolutionnaires prônée par la FA. Maurice Joyeux est dépité. Le CUAS aurait pu marcher, écrit-il un mois plus tard, malheureusement il « s’est heurté dès son début à des particularités de clan qui ont limité son efficacité. Tout se passe comme si les syndicalistes se trouvaient dans l’impossibilité d’élever leur compréhension à la hauteur des circonstances tragiques dans lesquelles se débat le mouvement syndical » [31]. Désormais, Joyeux va peu à peu s’effacer de la commission syndicale de la FA, laissant à Jean Boucher le soin de défendre la ligne.
Cependant, au sein de la CNT, la décision du CCN a créé une violente dissidence. Deux des plus grosses unions régionales, la 6e (Toulouse) et la 8e (Bordeaux), choisissent de se maintenir dans les cartels qu’elles ont créés, et la fédération du rail décide d’adhérer en tant que telle au CUAS. Le Libertaire leur ouvre ses colonnes. Carré, secrétaire de la 8e Région – qui menace de ne plus payer ses cotisations [32] –, y appelle à abandonner les « mesquineries, les petites querelles » et réaffirme que le CUAS peut être « l’embryon du renouveau syndicaliste [33] ». Fernand Robert, un des secrétaires de la fédération du rail, y incrimine le « sectarisme » de ses camarades anarcho-syndicalistes qui fait « plus de mal au syndicalisme que toutes les pantalonnades des réformistes [34] » car « l’état actuel du syndicalisme ne permet pas la politique du tout ou rien [35] ». Provocateur dans l’âme, Robert concentre les accusations de réformisme et de traîtrise au sein d’une CNT où l’atmosphère devient exécrable.
La fédération du rail, pointée du doigt comme le canard boiteux de la CNT, assume farouchement ses orientations, confirmées et approfondies lors de son 3e congrès, les 8 et 9 octobre 1949. Le compte-rendu qu’en donne Normandy dans Le Libertaire explique avec mille précautions de langage que la fédération du rail va désormais donner plus de place aux revendications immédiates « où l’esprit syndicaliste révolutionnaire est partout présent », qu’elle a décidé d’établir des contacts avec les autres fédérations de cheminots (« les statuts de l’AIT les recommandent d’ailleurs »), qu’elle a confirmé son adhésion au CUAS et qu’elle a décidé de présenter des candidats aux élections de délégués du personnel (« ce qui entraîne ipso facto [sa] représentativité ») [36].
Vu la violence de la crise traversée parla CNT, un congrès confédéral extraordinaire a été convoqué pour les 30 octobre et 1er novembre 1949. La décision du CCN de se séparer du CUAS y est confirmée, et les dissidents sont mis en demeure de quitter les cartels. La 8e Région s’incline. La fédération du Rail s’obstine.
La 2e conférence du CUAS : encore raté !
Mais voici qu’approche la 2e conférence du CUAS, programmée pour les 12 et 13 novembre 1949. La FA y place ses derniers espoirs de clarification d’une situation de plus en plus confuse dans les minorités syndicales. Une semaine avant, Jean Boucher, qui est désormais un des animateurs du Syndicats autonome des travailleurs du Livre, une scission de la CGT, décrypte les enjeux de la conférence dans Le Libertaire. Selon lui, de nombreux militants ouvriers quittent la CGT écoeurés, certains vont à FO en traînant les pieds, la plupart dans la nature. Or le CUAS « ne pouvait être le pôle attractif de ces camarades […] parce que comité de liaison de diverses organisations et non centrale ». Il faudra donc trancher la question cruciale : « centrale ou pas centrale ? » [37].
Une semaine plus tard, ce sont plus de 150 personnes qui participent à la conférence nationale du CUAS. Sont représentées la FNSA, la tendance Unité syndicale (trotskiste), la CNT-Rail, la minorité CGT des Produits chimiques, la minorité de FO-PTT, la minorité du Livre-CGT, le Livre autonome, les Métaux autonomes de Tours, l’UD-FO du Maine-et-Loire, le Syndicat national des instituteurs du Rhône (École émancipée), le Syndicat démocratique Renault.
La CNT a délégué Samson et Toublet, avec pour mandat de « dénoncer la duperie que promet d’être la nouvelle centrale en gestation si jamais elle arrive à se constituer » [38]. Dans la salle, ils ont la désagréable surprise de se trouver en présence des délégués de la CNT-Rail.
Albert Périer, pour l’UD-FO du Maine-et-Loire, poursuit l’idée que les minorités révolutionnaires pourraient réaliser leur unification au sein de FO « où l’on peut s’expliquer ».
En tout cas, le projet de nouvelle centrale est à nouveau repoussé. On lui met comme préalable un « front unique des forces syndicales réelles », « partant de la base ». Et de conclure, avec un savant dosage de terminologie trotskiste et libertaire : « Seul un tel front unique est capable, dans l’action directe, de préparer une véritable unification des travailleurs au sein d’une confédération démocratique indépendante à la fois des partis, des gouvernements et de l’État » dont le but serait « l’abolition du salariat et du patronat privé ou étatique ». Le projet de centrale est donc renvoyé aux calendes grecques… Pour la FA, c’est encore raté, mais elle n’en laisse rien paraître. Le Libertaire présente la désignation d’un Comité national provisoire d’unification syndicaliste comme une « nouvelle étape en avant » pour la reconstruction du syndicalisme [39]. Las, le CUAS ne progressera plus. Il n’y aura pas de « nouvelle centrale » et il finira par se disperser, victime de ses tendances centrifuges.
Quant à la CNT, c’est la crise générale. L’année 1950 va la voir s’enfoncer dans une spirale d’autodestruction sectaire. Pour avoir maintenu sa participation au CUAS, le secrétariat du Rail est exclu de l’organisation par le CCN du 29 janvier 1950. La fédération se disloque dans la foulée. Ailleurs, l’ordre de retrait des cartels a suscité une immense incompréhension de la base. À Bordeaux, à Toulouse, à Saint-Étienne, elle se traduit par une chute verticale des effectifs, les syndiqués préférant rejoindre FO ou les autonomes [40]. La crise entraîne par ailleurs une nette prise de distance entre la FA et la CNT, jusque là en quasi osmose. Fin novembre 1949, Jean Boucher cesse d’animer la page syndicale du Libertaire [41], dont Joyeux s’était peu à peu retiré. Il cède la place à Fernand Robert, en rupture de ban avec la rue de la Tour-d’Auvergne. Et dès le début de l’année 1950, la page syndicale du Libertaire cesse de publier la liste des adresses des syndicats CNT, qui était systématiquement donnée depuis 1947.
La débâcle de la stratégie de nouvelle centrale entraîne d’ailleurs des récriminations de toutes parts, et la page syndicale est le théâtre d’une brève cacophonie qui oblige Maurice Joyeux à faire une « mise au point nécessaire » : « cette page syndicale n’est ni la page de la minorité FO, ni la page du “Comité national provisoire d’unification”, ni la page de la CNT [42] », c’est celle de la commission syndicale de la FA qui y répercutera strictement l’orientation des congrès de la FA.
N’empêche, la stagnation du CUAS et l’effondrement de la CNT décourageront profondément certains syndicalistes de la FA, comme Maurice Joyeux. On le retrouvera quelques années plus tard, avec Jean Boucher, à la CGT-FO, devenue, par la force des choses, le seul point de ralliement viable.
Mais le résultat est là : sans le CUAS ni la CNT, la stratégie « troisième front » de la FA est désormais privée d’un support de masse. L’anarchisme français est définitivement pris au piège de la Guerre froide.
Guillaume Davranche
DU PERREUX À FORCE OUVRIÈRE
17 avril 1943 : Accord conclu au Perreux-sur-Marne pour la réunification de la CGT. Au bureau confédéral siègeront 6 réformistes et 3 staliniens.
Août 1943 : Lancement du bulletin clandestin Résistance ouvrière par Robert Bothereau.
15 septembre 1944 : Pierre Besnard, ancien secrétaire général de la CGT-SR, lance un « Appel aux syndicalistes révolutionnaires » à rejoindre la CGT réunifiée.
Mars 1945 : premier numéro de L’Action syndicaliste, bulletin de la Fédération syndicaliste française (FSF), tendance révolutionnaire de la CGT.
4-6 septembre 1945 : Au comité confédéral national, les staliniens apparaissent largement majoritaires. Le stalinien Benoît Frachon est élu co-secrétaire général avec le réformiste Léon Jouhaux. La CGT, inféodée au gouvernement où siègent des ministres PCF, empêche les grèves et freine les revendications ouvrières. C’est l’entente cordiale entre réformistes et staliniens.
20 décembre 1945 : Résistance ouvrière devient Force ouvrière. Les « Amis de FO » forment la tendance réformiste de la CGT, pilotée par Léon Jouhaux et Robert Bothereau.
8-12 avril 1946 : Le congrès national de la CGT est marqué par l’hégémonie stalinienne. Un mois après, la FSF scissionne.
Juillet 1946 : Grève nationale des PTT. Une partie des syndicats poursuivent la grève contre la volonté de la direction stalinienne. Dans les mois qui suivent, formation de comités d’action syndicaliste (CAS) dans plusieurs secteurs : PTT, SNCF, Métaux, Transports, Hôpitaux, Alimentation ; ils sont l’ébauche des futurs syndicats autonomes.
Décembre 1946 : Congrès fondateur de la CNT-F, impulsée par l’ex-FSF.
19 février 1947 : Mort de Pierre Besnard, leader historique de la minorité anarcho-syndicaliste de la CGTU, puis cofondateur de la CGT-SR et de la CNT-F.
Avril 1947 : La grève chez Renault oblige la CGT à entrer dans la lutte. Le PCF, incapable de stopper le mouvement, est chassé du gouvernement le 5 mai. Les staliniens vont désormais lancer des grèves en rafale.
Septembre 1947 : Sommet de neuf PC européens sous l’égide de l’URSS à Szlarska-Poreba en Pologne. Adoption de la doctrine Jdanov de guerre froide. Fondation du Kominform. Les PC français et italien sont chargés par Moscou de combattre le Plan Marshall. La CGT va initier contre lui plusieurs vagues de grèves.
12-13 octobre 1947 : Le CCN repousse la motion Bothereau favorable au plan Marshall par 832 mandats contre 101.
Novembre 1947 : Grèves insurrectionnelles à Marseille, qui s’étendent à tout le pays.
18 décembre 1947 : La conférence nationale des Amis de FO se prononce pour la scission. Le lendemain, les réformistes – à l’exception de Louis Saillant – démissionnent du bureau confédéral.
Décembre 1947 : Les CAS des PTT et de la SNCF rencontrent à plusieurs reprises la CNT et FO, et penchent pour FO.
Janvier 1948 : Le ministre des Affaires étrangères soviétique, Molotov, prévient son homologue britannique que si la France et l’Angleterre poursuivent le plan Marshall, elles connaîtront le « grabuge ».
2 Janvier 1948 : Entrevue entre la CNT (Jacquelin, Juhel, Snappe et Fontenis), et les autonomes (Hervé, Juliot et Racine). Ceux-ci proposent à la CNT d’intégrer ensemble la future CGT-FO pour y constituer un pôle révolutionnaire.
19 mars 1948 : Dans le Maine-et-Loire, constitution d’un comité de coordination comprenant 5 militants de FO (dont Patoux) et 4 de la CNT (dont Tharreau).
31 mars 1948 : Congrès syndicaliste de la métallurgie à Puteaux (Hauts-de-Seine). La majorité demande que la nouvelle confédération ne s’intitule pas CGT-FO et ne s’affilie pas à la FSM.
12-13 avril 1948 : Ier congrès de la CGT-Force ouvrière.
28 mai 1948 : Dans Le Libertaire, publication du « manifeste d’Angers » émanant des « UD-FO de l’Ouest », et appelant à un regroupement de « tous les syndicalistes quelle que soit leur appartenance syndicale ou qu’ils soient inorganisés » pour « défendre les intérêts des travailleurs en-dehors de toutes influences politiques, confessionnelles ou étatiques ».
13 juin 1948 : Congrès de l’UD-FO du Maine-et-Loire, qui choisit de se proclamer « UD syndicaliste confédérée » pour regrouper les sections de FO, de la CNT et autonomes. Gabriel Tharreau, secrétaire de la CNT et militant de la FA, est élu à la commission administrative avec Patoux.
24-26 septembre 1948 : IIe congrès de la CNT à Toulouse, qui se prononce pour la convergence avec les « syndicats autonomes et les minorités syndicales » en vue de la fonction d’une nouvelle centrale syndicale.
11-14 novembre 1948 : IVe congrès de la FA à Lyon. Fin du soutien exclusif à la CNT. La FA prend position pour la convergence de tous les syndicats « restés en-dehors de la servitude des partis ».
20-21 novembre 1948 : Conférence nationale des syndicats autonomes. Constitution du Cartel d’unité d’action syndicaliste (CUAS) sur une plate-forme assez proche du syndicalisme révolutionnaire.
1er mai 1949 : l’UD-CNT du Maine-et-Loire fusionne dans l’UD-FO.
8 mai 1949 : Conférence nationale de la Révolution prolétarienne. On y estime que le CUAS est un échec.
29 mai 1949 : Le comité confédéral national de la CNT décide de se retirer du CUAS. Fronde de certaines unions régionales (Bordeaux, Toulouse, Saint-Étienne) et de la fédération du Rail qui souhaitent s’y maintenir.
8-9 octobre 1949 : Tournant « réaliste » au 3e congrès de la CNT-Rail aux Sociétés savantes.
30 octobre-1er novembre 1949 : Congrès extraordinaire de la CNT pour régler la crise. La décision du CCN de mai de se séparer du CUAS est confirmée. Les unions régionales s’inclinent. La fédération du Rail s’obstine.
12-13 novembre 1949 : Deuxième conférence du CUAS avec plus de 150 délégués de la FNSA, de la tendance Unité syndicale (trotskiste), de la CNT-Rail, de la minorité des Produits chimiques-CGT, de la minorité de FO-PTT, de la minorité du Livre-CGT, du Livre autonome, des Métaux autonomes de Tours, de l’UD-FO du Maine-et-Loire, du SNI du Rhône, du SDR (Renault). La fondation d’une nouvelle centrale est à nouveau repoussée, mais on désigne un Comité national provisoire d’unification syndicaliste.
29 janvier 1950 : Le CCN de la CNT exclut le secrétariat de la FTR : Beaulaton, Robert, Pillerault et Regnault.






