 Grégory Chambat : Quand les instituteurs révolutionnaires prônaient « l’action directe en pédagogie »
Grégory Chambat : Quand les instituteurs révolutionnaires prônaient « l’action directe en pédagogie »

Après un premier entretien publié le mois dernier, Grégory Chambat (CNT) poursuit la réflexion menée dans son livre Pédagogie et Révolution. L’école dite « de Jules Ferry », après avoir muselé la classe ouvrière dans le sillage de la Commune, poursuit son combat contre l’école religieuse et fait son bilan en 1905. La critique de gauche est unanime 1, la République n’a pas créée une machine à émanciper mais bien à perpétuer le système de domination.
AL : Nous avions conclu le premier article sur la question de la reprise en main de son éducation par la classe ouvrière elle-même. Ton livre décrit bien les trésors de créativité qu’elle va déployer, jusqu’à nos jours, pour résister à l’école « d’État » et tenter d’inventer une éducation réellement populaire.
Grégory Chambat : En effet, il s’agit de mettre en place « la science de son malheur » (Fernand Pelloutier). Au début du XXe siècle, plusieurs congrès syndicaux actent le principe de la création d’écoles syndicales pour les enfants de la classe ouvrière. Mais très vite, cette ambition se heurte à trois problèmes majeurs.
D’abord celui du financement. La CGT, encore jeune à cette époque, n’a pas les moyens de soutenir un tel appareil au sein des bourses du travail.
Ensuite, il y a un problème tactique de fond : contrer le monopole de l’État sur l’enseignement supposerait de créer une école privée, fut elle ouvrière. La CGT, plutôt anti-étatiste, n’est pas choquée par l’idée, mais plusieurs militants, alors que se discute la séparation de l’Église et de l’État, s’opposent à une école en dehors de la république [1].
Jaurès, Gustave Hervé et même Sébastien Faure seront critiques sur l’enseignement qui y est dispensé, mais opteront pour une défense tactique de l’école laïque et pour une alliance de circonstance avec le parti anticlérical.
Le troisième point important est celui de la naissance d’un syndicalisme révolutionnaire enseignant. Séduits par la CGT, une poignée d’instituteurs et d’institutrices prônent alors « l’action directe en pédagogie » (Albert Thierry) au sein même de l’institution scolaire, essuyant les foudres de l’administration : mises à pied, révocations, déplacements d’office...
Pourtant, le corps enseignant est en partie « du côté » de la République …
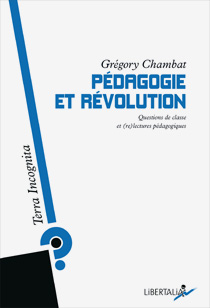
Grégory Chambat : Oui. Mais il ne faut pas négliger l’influence de l’affaire Dreyfus sur la profession. Ce qui est alors remis en question, ce n’est pas seulement l’armée, mais aussi la République dans son ensemble, y compris la justice et l’école. Cette école « du coffre-fort et de la Patrie » est contestée par les syndicalistes et par un courant antipatriotique chez les enseignants.
La fédération CGT de l’Enseignement sera la seule, avec celle des Métaux, à refuser l’union sacrée à partir de 1915, et à s’affirmer pacifiste pendant la Première Guerre mondiale.
Si les instituteurs révolutionnaires ont su gagner la reconnaissance de leurs camarades syndicalistes, l’immense majorité de la profession reste très modérée, les habitudes sont à la collaboration avec l’administration. De fait, le poids grandissant de la fédération de l’Enseignement influe sur l’orientation réformiste de la CGT.
Et le monde ouvrier attend autre chose de l’école qu’un enseignement nostalgique d’une France rurale et campagnarde (les fameux calculs de périmètres de champ et longueur de barbelés). Il aspire à un enseignement concret, correspondant à sa réalité urbaine, industrielle. Et partant, il imagine bien dispenser par lui-même une éducation fondée sur l’excellence technique.
Est-ce qu’on raisonne déjà à cette époque en termes d’une éducation autogérée ?
Grégory Chambat : Oui, même si le terme d’autonomie est moins anachronique. L’expérience malheureuse des Universités populaires — souvent créées par les bourses du travail — a renforcé la méfiance vis-à-vis d’un enseignement qui serait dispensé par les ennemis de classe. Ces bourses du travail, foyers de résistance et de culture ouvrière avec leurs bibliothèques, leurs cours professionnels, entendent réaffirmer que « l’éducation des travailleurs sera l’œuvre des travailleurs eux-mêmes ».
Est-ce au moyen de nouvelles formes pédagogiques qu’Albert Thierry ou Freinet pensent changer les choses ?
Grégory Chambat : Non. Ce sont avant tout des militants qui veulent renverser la société. C’est ce qui les distingue d’autres courants tels que « l’éducation nouvelle », formée de médecins, de passionnés de pédagogie, qui veulent la rationaliser.
Leur point de départ c’est le social, c’est se mettre au service d’une classe. Et là où l’école officielle veut émanciper des individus, eux visent le collectif. Freinet illustre ce point en évoquant les maîtres-camarades de Hambourg : « ils attendent la révolution en la faisant » : on n’attend pas le Grand Soir, on travaille à émanciper ici et maintenant, dans et hors de l’école. Les formes pédagogiques sont créées dans une volonté d’émanciper, de devenir autonome, de se réapproprier, au profit d’une classe, les moyens de la production du savoir.
Ces militants sont avant tout des praticiens, confrontés à une réalité concrète : c’est elle qui dicte les innovations de Freinet en milieu rural au lendemain de la guerre, et qui ne seront pas forcément entièrement transposable en banlieue parisienne dans les années 1960 et 1970. D’où leur renouvellement dans la pédagogie institutionnelle de Fernand Oury ou de Raymond Fonvieille. C’est bien la réalité qui crée la pédagogie, et non l’inverse.
Mais malgré la créativité inouïe de ces pédagogues engagés, l’éducation révolutionnaire ne prend pas, et se heurte à deux écueils insurmontables.
D’abord, le mouvement pédagogique est largement encadré par un PCF stalinien dont la vision politique est incompatible avec une éducation émancipatrice.
D’autre part, la stratégie conçue pour changer le système « de l’intérieur » devient un frein : dans les années 1960, l’école de Jules Ferry n’existe plus en tant que telle (début de la « massification » scolaire), et le discours révolutionnaire s’institutionnalise. Sous couvert d’égalité des chances et de démocratisation de l’enseignement, maladroites revendications d’une majorité d’enseignants, l’école affine et perfectionne, par des mécanismes subtils et moins voyants, le rôle qui a toujours été le sien : reproduction sociale et domination.
Pour conclure par une note optimiste, rappelons que les Freinet, Ferrer, Illich auront montré que l’alternative en éducation existe et qu’elle peut contribuer à produire de l’autonomie, de l’émancipation. Mais, avertit P. Freire « cette pédagogie des opprimés ne peut être élaborée ni mise en pratique par les oppresseurs. Il serait impensable que des oppresseurs encouragent et, a fortiori, pratiquent une éducation libératrice ».
L’expérience des écoles populaires kanaks (créées en 1985 dans la foulée de l’insurrection en Kanaky), du Chiapas ou d’Oaxaca, forment de précieuses leçons : sans un mouvement social de fond, l’éducation se heurte à trop forte partie. C’est pourquoi la question de l’éducation reste indissociable de tout processus révolutionnaire.
Propos recueillis par Cuervo (AL Banlieue Nord-Ouest)
Lire la suite de l’entretien dans Alternative libertaire d’octobre 2012.






